Par moment, il est difficile de vivre, vivre pleinement. Le monde est traversé de violence, la démocratie est rongée par le narcissisme et les abus, les nations se replient sur elles-mêmes ou écrasent leurs voisins, la nature nous renvoie nos déséquilibres par des incendies, inondations, grêles et sécheresses. Les corps sont douloureux, les émotions lourdes. Nos émois traduisent notre impuissance, notre impuissance les enflamme. Je n’y échappe pas, l’absurdité de notre civilisation me travaille depuis plusieurs années, la nuit hélas. Comment rester pleinement soi, sans se refermer ni détourner la tête de l’insupportable ? Gageure. Je ne connais que les quelques chemins que j’arpente, il y en a probablement de nombreux autres.
[Si vous souhaitez explorer ces chemins, rejoignez-nous à l’Atelier « Sains et respons-ables dans un monde qui tourne fou » que j’animerai les 22-23-24 août au Cloître St Thégonnec (Finistère Nord). Informations ici, ou via par mail ]
L’un des chemins est de poser des actes justes qui ne dégénèrent pas en incivilités. Un acte juste est éthique, c’est une action portée par le cœur et non par la rage. C’est par exemple cette pétition contre une loi biocide, qui récolte plus de deux millions de signatures en quinze jours. La jeune Française à l’initiative de ce cri du cœur est montée sur le pont, sans se laisser freiner par son éventuelle absence de résultat. Elle termine son texte par cette réflexion : “Aujourd’hui je suis seule à écrire, mais non seule à le penser”. Deux semaines plus tard, elle a récolté deux millions de signatures authentifiées, presque 3 % de la population française. Éléonore a réussi au-delà de tout imaginaire à incarner tout ce à quoi je crois, que nous avons tous un pouvoir de transformation. Par notre authenticité, nous pouvons contribuer à l’amélioration du monde. Il ne s’agit pas seulement de faire son petit colibri, mais d’oser poser des actes qui engagent notre sincérité. Des actes que l’on pose par loyauté envers soi-même, envers l’humanité, parce qu’on y croit intrinsèquement et non parce qu’on anticipe son effet.
Un autre chemin est de revisiter notre relation à la nature. La laisser entrer en nous plutôt que vouloir entrer en elle. Avez-vous déjà pris le temps de vous sentir regardé par un arbre dans la forêt, plutôt que le « prendre » en photo ? La nature était là avant nous, elle nous englobe, nous porte et nous nourrit. Elle est vivante là où nous ne l’épuisons pas. Ce n’est pas pour rien que les peuples anciens l’appellent la Terre-Mère, elle a tant à nous offrir si nous retrouvons le chemin vers elle. Cela demande de la lenteur, du silence, et de nous ouvrir à nos cinq sens. Impossible d’entrer en relation avec l’âme du lieu lorsque nous sommes absorbés dans nos pensées ou nos agendas minutés. Mais lorsqu’on s’offre ce cadeau, tout s’harmonise à l’intérieur.
Autre chemin. Écouter notre âme, dialoguer avec notre inconscient créateur. On m’objectera que s’il est inconscient, comment s’y relier ? L’inconscient parle la langue des images. Les images sont partout, dans les rêves, les intuitions, les métaphores, les voyages chamaniques, l’imagination active. Cela demande de lâcher notre cerveau gauche, celui qui veut analyser, mesurer, expliquer, prouver. Et on se retrouve toujours devant la même porte : celle de l’inexplicable, l’irrationnel, l’invisible, ce qui nous dépasse. Je ne prétends pas que l’irrationnel sauverait le monde, mais il ouvrirait les portes à la créativité, la relation et le lâcher-prise, il rééquilibrerait notre besoin de contrôler la vie et de dominer l’autre. Alors qu’au cœur de la première guerre mondiale, Jung était lui-même absorbé dans un dialogue confrontant avec son inconscient, il écrivit à l’une de ses patientes : “Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. À l’extérieur, tout semble discordant ; ce n’est qu’à l’intérieur que tout se fond dans l’unité. Celui qui regarde à l’extérieur rêve, celui qui regarde à l’intérieur s’éveille.”
Autre chemin encore. Retrouver son enthousiasme, dans son sens premier : en-theos : Dieu en soi. L’enthousiasme n’est ni l’excitation, ni la griserie, c’est une joie intérieure qui ne doit rien aux événements externes. On ne s’ouvre pas à Dieu facilement. D’abord, parce que, sur la forme, le terme a depuis longtemps été vidé de son sens par les églises, leurs dogmes, intolérances et images culpabilisantes. Ensuite, parce que, sur le fond, le rationnel à nouveau s’en mêle : Dieu ça n’existe pas, c’est une fuite de la réalité. Effectivement le divin, c’est irrationnel. Comme l’amour, non ? Deux facettes d’une même pièce. On me rétorquera que l’amour aussi est décevant, faits d’illusions, de trahisons et de deuils, mais qu’est-ce qu’une vie où on ne croirait pas en l’amour, avec ses heurs et malheurs ? L’Amour est le moteur de la vie — l’Amour avec une majuscule, pas nos petites dépendances, projections, recherches de sécurité, avec lesquelles nous le confondons si souvent, nous satisfaisant de peu. Peu importe le résultat, seule importe la quête. Brel le chantait si bien, “Telle est ma quête, Suivre l’étoile, Peu m′importent mes chances, Peu m′importe le temps…” Alors il faut aller chercher Dieu, il faut aller chercher l’Amour, il faut aller chercher l’Infini. Einstein disait : “Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l’a engendré”. C’est du boulot. Il faut dépasser la torpeur du corps, le doute du mental, le risque de l’incompréhension. On ne rencontre pas Dieu par tradition familiale ou culturelle, ni par la vertu d’un rituel, ni en s’y forçant. Si ce n’est par la grâce, on ne peut le rencontrer qu’acculé. Ce que nous ne pouvons conscientiser de l’intérieur vient à nous de l’extérieur. Par exemple, nous refusons de ralentir notre rythme trépidant, et un accident survient qui nous immobilise dans le plâtre ou à l’hôpital. Peut-être les dégradations planétaires du vivre-ensemble dues à la folie du monde — son hubris,pour reprendre le terme grec qui désignait la folie des hommes se croyant égaux aux dieux — sont-elles l’accident qui nous arrive pour retrouver l’humilité au cœur de notre vie.
S’il n’y avait qu’une prière, ce serait celle-ci : “Je reconnais ma finitude et je m’incline”. Avec cette prière s’éteint l’incendie intérieur de ma colère d’impuissance. On ne nous apprend pas à prier. Prier signifie pour moi reconnaître, honorer, saluer, s’incliner avec respect. C’est faire acte d’humilité. Cette humilité que les hommes ont perdue à force de ne croire qu’en eux-mêmes et dans les technosciences. Plutôt que nous débattre avec notre impuissance au risque de la laisser dégénérer en violence, peut-être devons-nous entrer dans son acceptation ? Je sais, je me répète, mais ce sont les mots qui reviennent dans la nuit. Notre illusion de toute-puissance sème la mort. Aussi fou que cela paraisse, je voudrais danser mon impuissance.



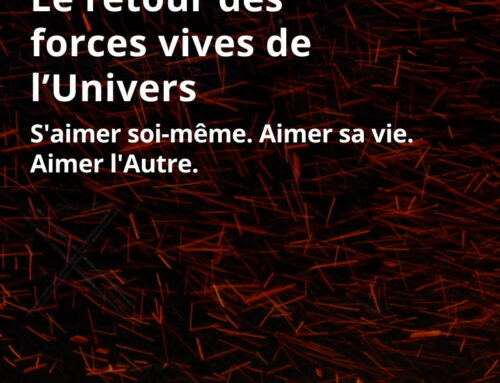

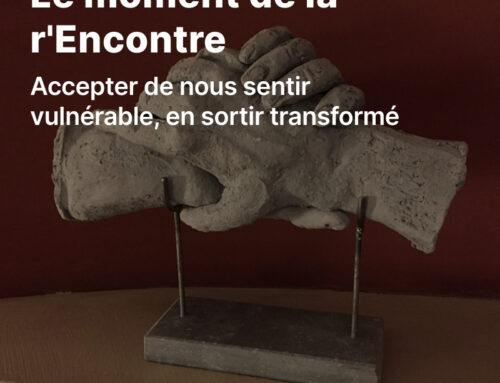
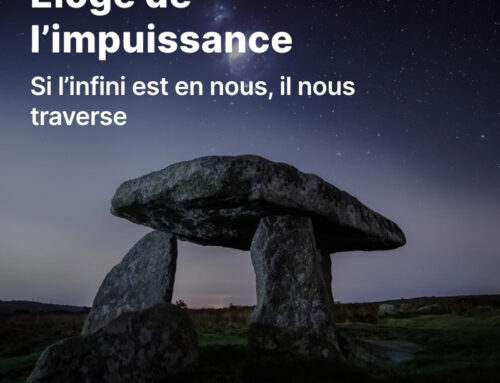
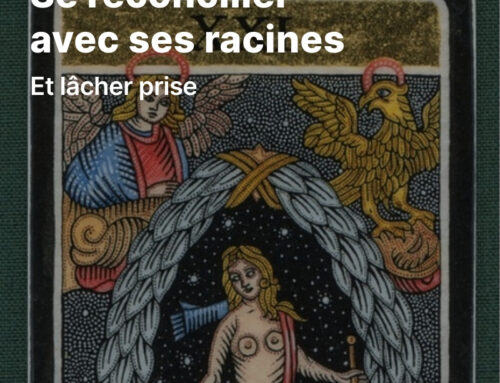
Laisser un commentaire