Il semble que nous ayons été unanimes à rendre hommage à Robert Redford pour son engagement écologique et humaniste, bien au-delà de son seul charme, comme si quelque chose de sa conscience vibrait en nous. Et pourtant, que de réticences à marcher sur ses traces…
Depuis que j’ai l’âge d’observer le monde, j’ai vu notre société perdre peu à peu le sens de l’altérité, et ce ne sont pas les années 2020 qui me contrediront. À quand cette indifférence à l’autre, si ce n’est pour l’exploiter, remonte-t-elle ? Les années 2010 et leurs soi-disant crises migratoires ? Les années 2000 et l’avènement des selfies ? Les années 90 et le surgissement du numérique nous permettant de nous exprimer à tout va sans plus prendre le temps d’écouter ? Les années 80 et l’affirmation tranchante du capitalisme financier et de la loi du marché, There is no alternative ? Les années 70 et le sea-sex-&-sun jusqu’à banalisation de la prédation ? Les années 60 qui prétendaient naïvement interdire d’interdire et tout nous permettre ? Les années 50 et l’abondance sans limites des trente Glorieuses ? Plus tôt encore, avec les redécoupages territoriaux dans l’intérêt des vainqueurs, qu’il s’agisse des puissances coloniales ou des accords de Yalta ? Au fond, remonter l’histoire m’importe peu, si ce n’est pour constater cette lente décrépitude de l’humanisme à laquelle nous prétendons.
Ma conscience de l’autre est née avec ma conscience écologique, à l’âge de 14 ans. À la descente d’un autobus, en Angleterre, j’avais jeté sur le sol le papier d’emballage de mon chewing-gum et un vieux monsieur m’avait interpellée et demandé que je le ramasse, éveillant en moi un mélange de honte et d’étonnement dont je garde vivace le souvenir. Ce n’était encore qu’une notion de base : un papier de chewing-gum sur le sol, cela enlaidit le paysage. Plus tard m’est venue la conscience qu’en polluant notre milieu, nous encrassons notre propre santé, physique et psychologique ; il existe une corrélation entre la manière dont on traite ce(ux) qui nous entoure(nt) et notre estime de soi. Bien plus tard encore, je réaliserais enfin que la Nature n’est pas notre « environnement » : elle est notre matrice naturelle, elle nous englobe dans une intrication mutuelle. Les peuples premiers, de culture chamanique, n’ont jamais cessé de l’aimer et la respecter, ils l’appellent d’ailleurs affectueusement la Pachamama, la Terre-Mère. Par contre, nous, les Occidentaux, qui nous prétendons civilisés, sommes dénaturés au sens radical du terme : la Pachamama nous la traitons comme une femelle dont on exploite les pis jusqu’à épuisement. Même notre écologie est restée orientée vers notre propre confort. C’est d’abord avec le phénomène NIMBY, Not In My Backyard, pas chez moi, que je l’ai vue devenir conditionnelle : les actions d’intérêt général, on est pour, tant qu’elles ne portent pas atteinte à nos habitudes et notre confort. Aujourd’hui, comme seule réponse aux canicules qui menacent la biodiversité et les habitats, nos partis politiques ne proposent que des plans de confort autocentrés : « ma clim » d’abord, et tant pis si elle rejette de la chaleur dans les rues et augmente le réchauffement pour tous. Notre refus des contraintes qu’implique de prendre soin de notre Terre est si massif que nous en sommes arrivés à rejeter l’écologie comme « punitive ». Il en est de l’Autre comme de la Terre. Nous ne manifestons pas plus d’affection et de respect envers la Terre qu’envers les plus fragiles, femmes, enfants, migrants. Lorsque la bulle euphorique de la mondialisation a éclaté, notre réflexe égocentrique s’est étendu comme une tache d’hydrocarbure aux politiques migratoires : c’est le même NON qui s’oppose aux migrants rêvant de jours meilleurs et aux éoliennes qui nous gâcheraient la vue, et l’on a vu des anonymes parqués dans des bidonvilles ou échoués sur des plages. Notre indignation n’est jamais plus qu’un spasme émotionnel, non suivi d’actions.
Notre fermeture à l’autre est indéfendable sur le plan éthique : la Terre ne nous appartient pas, et nous Occidentaux avons d’autant moins de droits sur notre parcelle de globe terrestre que nous avons été prédateurs des autres continents. Pour aligner notre égocentrisme sur notre conscience, nous modifions nos croyances en recourant à des images excessives, soutenues par une pseudo-rationalité financière ou socio-économique : Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, affirmait un ministre français en 1989. Bienvenue la dissonance cognitive, exit l’altruisme — littéralement, la conscience de l’autre. Après le temps béni des colonies est venu le temps maudit des exterminations : nous nous entretuons pour des métaux rares et des énergies fossiles, nous déforestons pour bétonner, nous expulsons loin de leurs terres des populations dont nous convoitons les ressources. Le temps où nous pouvions prétendre ne pas savoir est révolu, l’information est partout. Alors, nous nous détournons, nous suradaptons, nous agitons, nous nous lavons les mains comme Ponce Pilate, Not In My Name. Le discours collectif reste celui du déni de respons-abilité (la capacité d’offrir une réponse) qui nourrit l’impuissance et la passivité. Qui s’étonne encore que nos Sommets — sur le plastique, la pollution des océans, la paix dans le monde — restent des grand-messes sans lendemain ?
En réalité, nous sommes tous reliés, tous des fractales de l’humanité, tous respons-ables de Gaza, de ces migrants jetés sur les routes, de ces océans qui étouffent, de ces forêts qui brûlent. Nous ne sommes pas juste des témoins impuissants d’abjections humaines commises par d’autres, nous sommes imprégnés d’une culture biocide, en sommes parties prenantes : le rejet de l’autre — surtout lorsqu’il est vulnérable, fait partie de notre Ombre collective. Jésus (un Sage que je distingue des cultes perpétrés en son nom) disait « Ce que tu fais à un autre, c’est à moi que tu le fais ». De même, la tradition alchimique résume cela en une formule : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». En d’autres mots, le microcosme et le macrocosme se renvoient en miroir. I
Il m’arrive, comme à la plupart d’entre nous, de vouloir ignorer les évènements qui affligent le monde et de me recentrer sur mon petit microcosme. Cela ne dure pourtant qu’un temps. Toujours revient cette interrogation : comment respondre à cette haine de l’Autre ? Comment retrouver un engagement écologique et humaniste ? Je ne peux distinguer l’homme et la Terre. Quatre directions se proposent en moi. UN. En ouvrant un dialogue, une confrontation avec nos parts sombres, nos propres individualismes et après moi les mouches. Aller à la rencontre de nos ombres, cela a une résonance moins noble qu’aller à la rencontre de son âme. Mais on ne rencontre pas celle-ci sans rencontrer celles-là. On ne meurt pas d’un face-à-face avec nos ombres, on meurt de les renvoyer dans l’inconscient. Romy Schneider, dont la mère était une amie de Hitler, se sentait respons-able du nazisme. Sa response a été d’incarner plusieurs rôles de victimes juives, de donner à ses enfants des prénoms juifs, de porter une étoile de David autour du cou, avec laquelle elle a été inhumée. Par ses choix, elle exprimait sa conscience de ne pas être indemne de ce mal collectif. Les Allemands sont peut-être ceux d’entre nous qui ont fait avec leur Ombre collective le plus grand travail de confrontation et d’intégration. Nous, Européens, prétendons à un humanisme qui masque mal nos propres abus, que nous rechignons toujours à regarder en face. Et que dire de ces arrogances mondiales, au Nord, au Sud , à l’Est et à l’Ouest, qui perdent leur âme dans des politiques de rage ?
DEUX. En agissant à partir de l’appel de notre âme. Quand le bateau gîte dans des flots tourmentés, il s’agit de faire contrepoids. Si nous abandonnons le navire, nous nous abandonnons. L’action juste, c’est celle où nous donnons le meilleur de soi, celle par laquelle se manifeste notre être profond. Dans un monde où chacun serait branché sur son âme, il n’y aurait plus de place pour la haine et la rivalité. Utopiste ? Et pourquoi pas ? Il ne s’agit pourtant jamais, dans mon esprit, de rechercher une action qui par voie de causalité aurait un effet transformateur magique : cette ambition relèverait d’une prétention naïve. Je crois d’ailleurs que ces évènements monstrueux qui se succèdent sont là pour nous transformer, et non l’inverse. Pluton (la transformation) est récemment entré en Verseau (l’Humanité) et y œuvrera pour vingt ans.
TROIS. En faisant muter nos colères. J’en distingue de trois types. La sain(t)e colère qui nomme l’injuste, l’inacceptable, et appelle une response par respect de soi et de l’autre : elle est déterminée et posée, elle appelle à se tenir debout et à agir à partir de notre âme. La colère régressive, que l’on connaît dès l’enfance et se nourrit de frustration : elle nous épuise en vain, nous faisant vivre deux colères pour le prix d’une, celle de l’injustice et celle de l’impuissance. La colère toxique qui véhicule la haine de l’autre et le pouvoir par la terreur, et qui infeste les politiques ravageantes de l’actualité mondiale : paradoxalement, cette colère-là masque une immense peur inconsciente et découle de la précédente. Pour retrouver la voie de la sain(t)e colère, il nous faut identifier nos pentes de colère régressive et de colère toxique, et les remonter. Elles sont assez facilement reconnaissables lorsqu’on se rend attentif à ses sensations corporelles : elles nous plongent dans un état de bouillonnement et d’agitation (respiration courte, rythme cardiaque accéléré, tension élevée, etc) qui manifestent la passivité de notre réponse. L’Analyse Transactionnelle, une théorie psychologique de la relation à soi et à l’Autre, a montré comment la passivité culmine en violence.
QUATRE. En cultivant un réel sentiment d’appartenance et d’unité avec autrui, en renonçant au déni de l’autre et à la prise de pouvoir sur les plus faibles, en retrouvant le chemin de la solidarité envers l’Autre. Nous ne pouvons contribuer à l’émergence d’un monde interrelié qu’en devenant compatissants, en éprouvant de la délicatesse et de la bienveillance envers ceux qui n’ont « rien » à nous à apporter — si ce n’est de réapprendre à aimer. Retrouver le chemin de l’Amour, c’est du boulot ! Je ne parle pas ici de nos amours conditionnelles, l’amour de ceux qui nous font du bien, le petit amour relationnel soumis à des efforts de part et d’autre, mais de l’amour de bienveillance — l’agapè de la philosophie grecque. Cet amour-là est capable de ressentir de la compassion pour les vulnérabilités que recouvrent les réactions agressives/défensives. Il n’empêche pas une lucidité et une capacité à s’opposer aux comportements injustes et destructeurs par une sain(t)e colère : je ne te laisserai pas faire mais je ne te hais pas.
Je ne suis pas plus douée que les autres pour aimer sur la bonne octave, je suis juste capable de reconnaître, pour les avoir amplement vécues, les fausses notes : l’amour conditionnel (je t’aime parce que tu me fais du bien) l’amour narcissique (je t’aime parce que je me vois en toi), l’amour passionnel (je t’aime parce que je suis accro à toi). Ce à quoi je me sens invitée et ce que je vous partage donc, c’est d’aller un peu plus loin, de s’éclaircir la voix, d’oser une note plus haute. Cela demande de se réinventer. Mais notre monde a urgemment besoin d’engagement au service de l’Amour.



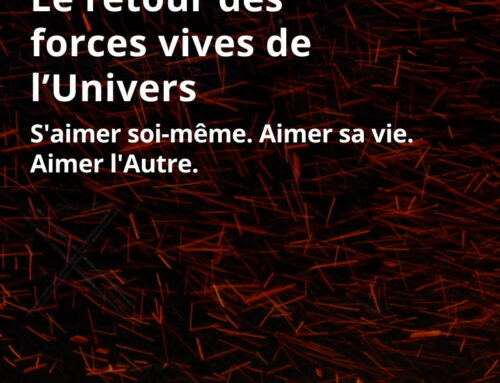

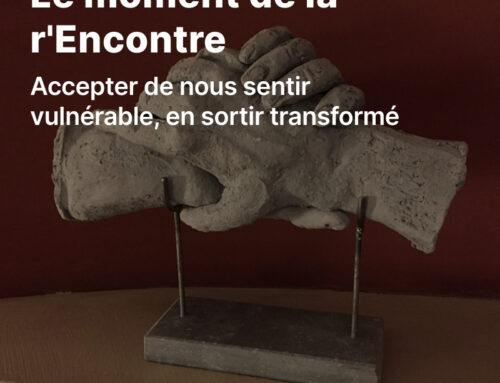
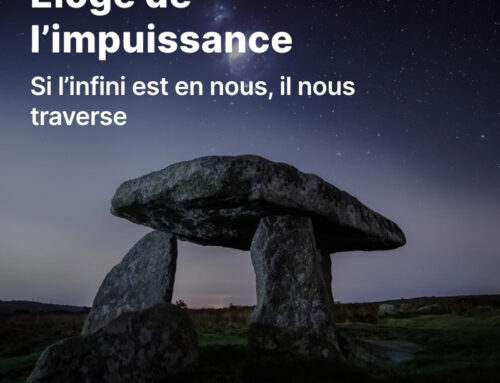
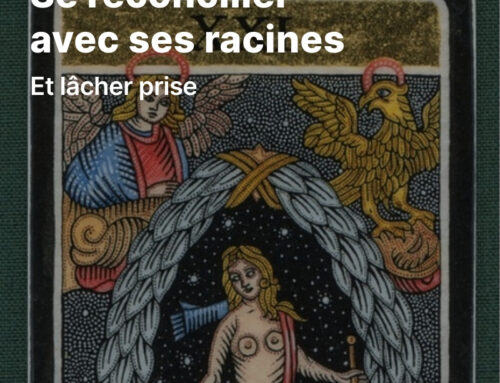
Laisser un commentaire