Pour rester solides dans cette époque délétère et réenchanter la vie, nous avons besoin de nos deux pieds, celui de la raison et celui du merveilleux.
Un de ces derniers matins, il m’est ainsi arrivé qu’un pigeon sur un fil électrique s’invite à l’improviste au fond de ma rétine.Avant même que j’aie le temps de penser, les mots me sont venus, ceci n’est pas un pigeon, et j’ai ressenti comme une grande respiration intérieure. La perception avait précédé le langage. Bien plus qu’un bipède ailé perché sur son fil, mes sens avaient reçu une forte vibration de vie ayant apparence d’oiseau embrassant la nature de son œil de pigeon. Ce volatile de plumes et d’os n’était pas plus un pigeon que nous ne nous réduisons à une enveloppe corporelle ; tout comme, sous l’apparence d’un cerf, c’est le patronus de Harry Potter qui se manifestait. Dans la tradition chamanique, on dirait que j’ai rencontré l’esprit Pigeon, sans avoir eu besoin de battre le tambour. Mes sens étaient simplement ouverts au Vivant. J’ai vécu un flash extatique, au sens où un philosophe du siècle dernier, Jules Vuillemin, a décrit l’extase : un mouvement du destin qui rend intérieur ce qui est extérieur.
Il ne s’agit pas de croyance ou d’adhésion à un discours mais d’une expérience subjective. Elle est à la portée de quiconque développe sa présence dans l’instant. Là aussi, il ne s’agit pas d’une expression philosophico-ésotérique mais d’une invitation à suspendre notre tendance à nous projeter dans le futur — optimiste ou pessimiste — et à se laisser surprendre par ce qui est là. C’est une qualité de présence à la qualité d’un moment. Le printemps y est propice. Le soleil monte dans le ciel, la brise porte les sons et les odeurs, sur les cimes les oiseaux célèbrent triomphalement la nidification en cours. Tous les sens sont conviés. Les terres noires sont fraîchement retournées, d’autres finement peignées attendent un semis, d’autres encore laissent émerger déjà un aura vert pâle de germination. Certaines fleurs font une brève apparition comme la ficaire printanière, une jolie renoncule jaune vif qui, comme son nom l’indique, n’apparaît que fugacement — elle aussi continuera d’exister, même redevenue invisible.
Pour goûter pleinement l’instant présent, nul besoin de volontarisme, bien au contraire. Orienter son regard amoindrirait la réceptivité à ce qui est là, de la même manière que l’écoute active ou l’écoute flottante demandent de ne pas « tendre » l’oreille. Il s’agit plutôt de renverser les postures, se laisser regarder par les arbres ou les buissons, se laisser envelopper par la musicalité du moment, comme par une brume. Se laisser imprégner plutôt que vouloir appréhender. En laissant la nature entrer en soi, une bascule se fait et elle nous invite en retour dans son univers. Un peu comme Mary Poppins pénétrait dans le tableau dessiné à la craie sur le trottoir, ou Harry Potter accédait au quai 9 3/4 de la gare de King’s Cross à travers un pilier de briques : un autre monde, plus subtil, ne demande qu’à nous accueillir si nous-mêmes nous ouvrons à sa possibilité. À ceux qui ne me suivraient pas de prime abord, je proposerais de se relier à leur expérience de lecteur ou de cinéphile : qui ne s’est senti projeté dans un autre univers par une scène d’horreur, d’amour ou d’érotisme ? Notre corps est traversé d’émois, de sensations, de désirs, pourtant il ne s’agit que de papier et d’encre, du défilement d’une pellicule devant une source lumineuse. Il a suffi d’une odeur pour que se réveillent « des formes ensommeillées » et que la tante Léonie revive avec sa tisane et ses madeleines ; et aujourd’hui encore il suffit des lignes de Proust pour être nous-mêmes conviés au réveil dominical de cette tante. L’écrivaine Catherine Cusset a rédigé sa thèse de doctorat sur l’œuvre de Sade tant elle avait été troublée dans son corps par la lecture d’une scène de Justine, ou les Malheurs de la vertu, et intriguée par cette réalité ressentie. En certains cas de science-fiction, c’est même un univers réel du futur qui apparaît sous la plume de l’auteur bien avant sa matérialisation. Pensez à Verne ou Orwell.
Ce monde qui surgit au-delà de l’espace-temps, c’est le monde de l’âme, suprasensible, le monde imaginal, pour reprendre le terme de Henry Corbin, philosophe spécialiste du soufisme. Plus nous nous laissons toucher dans nos sens et nos émotions, plus nous avons de chance d’y accéder. Au début, c’est comme apprendre à marcher. Un pied sur le sol, l’autre en suspens, progressivement, on apprend à avancer sans se déséquilibrer.
Je n’ai rien contre la rationalité, et tout contre son unilatéralité. Nous vivons sous un biais rationnel excessif qui ramène tout au tangible et mesurable et tend à émousser notre enthousiasme — dont l’étymologie (ramenons un peu de raison) est en-theos, habité par les dieux. Est-on touché par l’esprit de la cathédrale de Chartres en apprenant que la hauteur de sa flèche à 113m tient le record mondial d’élévation derrière la pyramide de Khéops, 147m ? Ou en laissant infuser en nous l’atmosphère des lieux, assis en silence dans la nef ? Il faut voir un petit enfant s’extasier devant une bestiole qu’il voit pour la première fois, entendre son Ahhh ! réjoui, qui s’éteint dès qu’un plus grand, déjà immunisé de la joie de surprise — en un mot, blasé — lui explique « ben quoi, c’est… [un escargot, un scarabée, une coccinelle] ! » Il y a dans ce ben quoi, un meurtre du merveilleux. Certes, nous avons besoin de raison pour nommer les choses, les différencier, les mettre en relation les unes avec les autres. Cependant, l’esprit rationnel qui voudrait tout réduire à une matérialité ne laisse plus de place à l’enchantement et contribue au démantèlement du monde. Famille, église, école, hôpital, séparation des pouvoirs, démocratie…, nos institutions se fragilisent les unes après les autres — elles étaient loin d’être parfaites mais avaient le mérite d’exister, d’offrir des cadres structurants, des repères. Tout ce qu’il y avait de valeurs là-dedans s’est petit à petit dissout à coups de chiffrages, statistiques, mesures de financements et retours sur investissement. Un monde sans émerveillement, sans poésie, s’expose à la violence.
La nature est vivante, elle a sa propre vie dont nous nous excluons si nous restons confinés dans la rationalité. Pour réenchanter le monde, le revitaliser, il faudrait peut-être commencer par sortir de chez soi, se replonger dans la nature et la laisser entrer en nous. Sans enchantement, sans enthousiasme, il ne restera qu’une morale mortifère, sous le coup de lois et interdits, plutôt qu’une éthique vivante nourrie par le cœur.
Un auteur britannique du siècle dernier, G.K. Chesterton, journaliste, poète, catholique et occultiste, a écrit que le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d’émerveillement. C’est le moment de s’en souvenir.


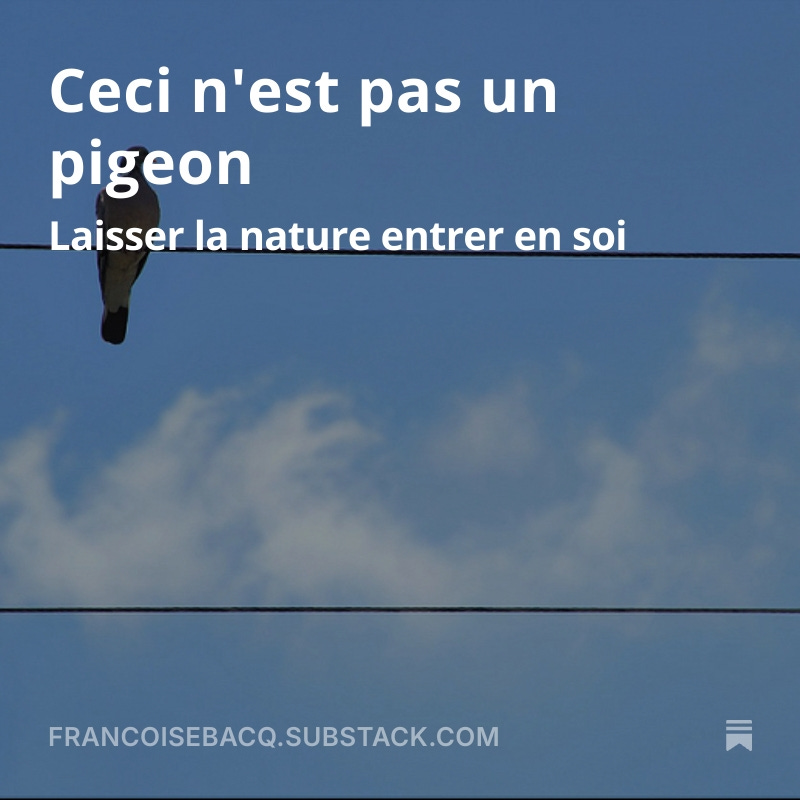
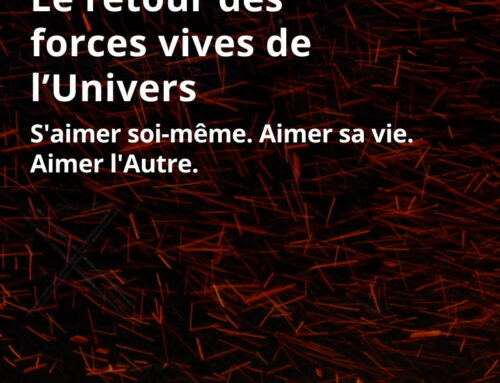


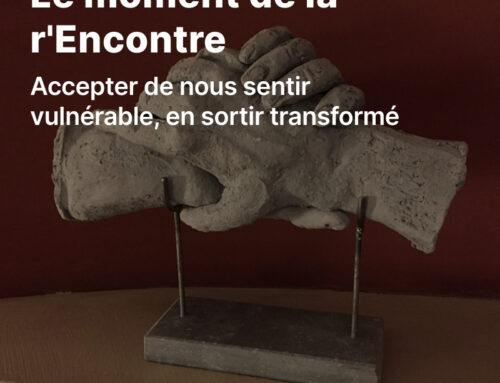
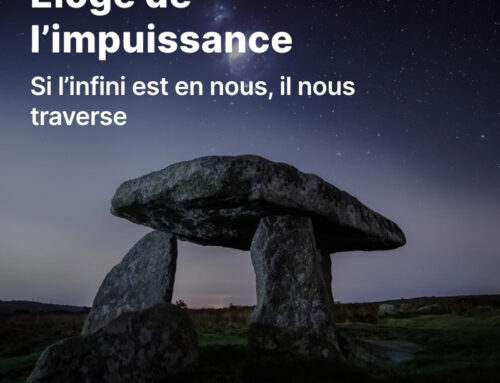
Laisser un commentaire